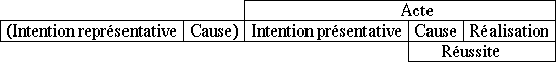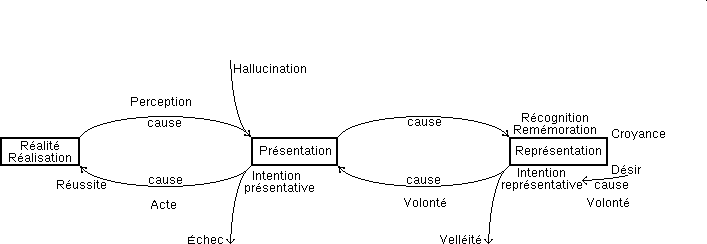|
Intention, acte et réflexe
Une intention est l'imagination présentative ou représentative de quelque chose, comme causant la réalisation de cette chose, en la faisant soi-même. Par exemple, je peux avoir l'intention de crier car c'est moi-même qui crierais; je ne peux pas avoir l'intention qu'une autre personne crie car ce n'est pas moi-même qui crierais (je ne peux pas faire moi-même qu'elle crie); je peux avoir l'intention de la faire crier car je peux moi-même la faire crier. Il est impossible d'avoir l'intention de faire ce dont on est certain de l'irréalisabilité (par soi-même).
On ne peut avoir l'intention de faire que ce qu'on
peut avoir l'intention de ne pas faire. Un acte est la réalisation (par soi-même) d'une intention à soi, causée par cette intention comme celle-ci la présente (ou la présentait). Par exemple, un jeune homme a l'intention (représentative) de tuer son oncle; il est en train de conduire, et son intention de tuer son oncle le préoccupe tant, le rend si agité et si nerveux qu'il écrase accidentellement et tue un piéton qui se trouve être son oncle; dans ce cas, il a tué son oncle, et son intention (représentative) de tuer son oncle a causé la mort de son oncle, mais il n'a pas tué son oncle intentionnellement (il n'a pas eu d'intention présentative).
Dans un acte, la réalisation de l'intention fait
partie de l'acte, alors que dans la perception, la réalité perçue ne fait pas
partie de la perception mais y est nécessaire.
Par exemple, le
lever d'un bras fait partie de l'acte de lever un bras, alors qu'il ne fait pas
partie de la vision du lever d'un bras, mais est nécessaire pour qu'il y ait
vision du lever d'un bras.
Une réussite est
le fait qu'une intention cause sa
réalisation telle qu'elle la présente.
Tableau sur l'acte:
Un acte peut en contenir (ou impliquer) d'autres.
Par exemple, si
je conduis une voiture, c'est un acte car je le fais intentionnellement, qui
implique d'autres actes, comme de tourner le volant, de freiner ou d'accélérer.
Si un homme qui
intentionnellement meut son bras de bas en haut, intentionnellement actionne
ainsi une pompe, intentionnellement remplit par là une citerne d'eau
empoisonnée et intentionnellement tue de ce fait les habitants d'une maison
approvisionnée en eau par la citerne, il a quatre intentions et fait quatre
actes; il peut y avoir réussite ou échec pour chacun des quatre faits, chacune
de ces quatre étapes.
Un échec
ou ratage
est
le fait qu'une intention ne cause pas sa
réalisation telle qu'elle la présente.
Il est impossible d'avoir l'intention d'échouer
(mais on peut avoir l'intention de feindre ou de simuler l'échec).
Si l'intention est réalisée et que ce n'est pas
l'intention qui a causé sa réalisation, il n'y a ni acte, ni réussite, ni échec.
Par exemple, si
Alpha demande à Bêta de partir et que Bêta part sans avoir entendu la demande
d'Alpha, Alpha n'aura ni réussi ni échoué à faire partir Bêta.
Si une intention cause sa réalisation mais pas comme
elle la présente, il n'y a ni acte, ni réussite, ni échec. Par exemple, un homme tente de tuer quelqu'un en lui tirant dessus; il le manque mais le coup sème la panique dans une bande de sangliers et ceux-ci tuent la victime désignée en l'écrasant; il n'y a alors pas eu meurtre intentionnel. Par exemple, un humain ne peut pas lever le bras parce que ses nerfs ont été sectionné; malgré tous ses efforts, il ne peut pas décoller son bras du corps; il réitère sa tentative sans succès; un jour, pourtant, il essaie avec tant d'énergie qu'il heurte, en cours d'effort, un commutateur qui met en action un aimant situé dans le plafond, et l'aimant attire le métal de son bracelet-montre et lui fait lever le bras: la levée de son bras n'est pas un acte, car elle n'a pas été faite par les intentions de la personne; si l'humain est informé de la présence de l'aimant et qu'il sait qu'il peut lever le bras par simple déclenchement d'un commutateur mettant l'aimant en action, la levée de son bras est un acte.
On peut réussir (faire un acte) ou échouer sans en
être conscient, sans le savoir.
Un sujet n'a pas nécessairement l'intention de réaliser
tous les effets qu'il croit que causeront ses actes.
Par exemple, le
chirurgien qui croyait qu'il allait faire souffrir son patient en l'opérant n'a
pas échoué s'il ne l'a pas fait souffrir.
Par exemple, si
un dentiste croit que le forage de la dent d'un patient causera une douleur,
cela n'implique pas qu'il veuille cet effet; si la douleur n'advient pas, il
n'affirmera pas: "`J'ai échoué.'" mais plutôt: "`Je m'étais
trompé.'".
Par exemple, Œdipe
eut l'intention d'épouser Jocaste mais, quand il l'épousa intentionnellement,
c'est sa mère qu'il épousait inintentionnellement; c'est aussi
inintentionnellement qu'il déplaça un certain nombre de molécules, causa
certains changements neurophysiologiques dans son cerveau et modifia sa relation
spatiale avec le pôle Nord de la Terre.
Par exemple, Œdipe
a l'intention de combattre l'étranger sur la route, et c'est dans l'intention
de combattre qu'il saisit une arme, dans l'intention de frapper qu'il lève le
bras, mais il n'a pas l'intention de combattre et de tuer son père, car il
ignore que cet étranger est son père.
*
Un essai ou
tentative est l'ensemble d'une
intention présentative et de certains actes afin de la réaliser.
Essayer,
c'est faire certains actes afin de réaliser une intention présentative.
Essayer,
c'est faire certains actes avec l'intention présentative d'en faire d'autres
par ces actes (par eux, par leur moyen).
Un essai ou
tentative est une intention de
(faire) quelque chose par certains actes.
Par exemple, si
une personne essaie de soulever un meuble et qu'elle y échoue, c'est qu'elle
aura déjà fait les actes de tenir le meuble et d'exercer une force vers le
haut.
Par exemple, si
une personne essaie de soulever un meuble et qu'elle n'y parvient pas (elle échoue),
c'est qu'elle aura déjà intentionnellement tenu le meuble et exercé une force
vers le haut.
*
Éviter,
c'est causer intentionnellement l'irréalisation de quelque chose.
Un évitement
est la causation intentionnelle de l'irréalisation de quelque chose.
Un évitement
est un acte de causation de l'irréalisation de quelque chose.
Éviter,
c'est faire quelque chose (intentionnellement) afin de causer l'irréalisation
de quelque chose.
L'évitement est le premier acte.
*
Un réflexe est
un mouvement (une contraction de muscle(s) ou une sécrétion de glande(s)) causé
inintentionnellement par le système nerveux.
Un réflexe est
la causation inintentionnelle des nerfs sur les mouvements des muscles ou les sécrétions
des glandes.
Un réflexe est
la causation non-finalitaire des nerfs sur les mouvements des muscles ou les sécrétions
des glandes, sans remémoration ni imagination.
Par exemple, le
frisson, la sudation, l'éternuement, la toux, le rire, le ronflement, le
sommeil, la contraction ou la dilatation des pupilles des yeux selon la
luminosité, l'éloignement soudain de la main d'un poêle brûlant sont des réflexes.
On peut avoir l'intention d'avoir un réflexe, mais
l'intention d'avoir un réflexe ne fait pas partie du réflexe, ce qui fait que
le réflexe n'est pas un acte.
Par exemple, on
peut avoir l'intention de rire en allant à un spectacle comique; on peut avoir
l'intention de faire contracter ses pupilles en mettant plus de lumière.
Tousser et rire
ne peuvent pas être des actes: on ne peut ni tousser ni rire
intentionnellement, car ce sont des réflexes; mais (se) faire tousser ou (se)
faire rire peuvent être des actes: on peut (se) faire tousser ou (se) faire
rire intentionnellement.
La causation de la mémoire virtuelle (mémoire non
remémorée) sur les muscles ou les glandes implique le réflexe.
*
Un instinct est
un réflexe causé génétiquement.
Un instinct est
une causation génétique de mouvements de muscles ou de sécrétions de
glandes.
L'instinctivité
est la causalité génétique du comportement ou de l'intentionnalité.
La migration et
la nidification sont instinctives chez certains oiseaux.
Chez le
nourrisson humain, la fermeture de la main causée par un contact de la paume,
et les mouvements de tétée sont des réflexes instinctifs.
*
Un comportement
est un système d'actes ou de réflexes.
*
Une motivation
est une croyance ou un sentiment (ou un affect) en tant qu'il cause consciemment
une intention chez celui qui l'a.
*
La volonté
est l'intentionnalisation de désirs dont on n'est pas certain de l'irréalisabilité,
ou le fait que l'intention représentative cause l'intention présentative.
La volonté est
le désir intentionnalisé.
Par exemple, si
on désire qu'une autre personne vienne, ça ne reste que du désir si on ne
fait rien afin qu'elle vienne; ça devient de la volonté si on fait
intentionnellement quelque chose afin de réaliser ce désir, par exemple si on
lui demande de venir ("`Viens.'" ou "`Je veux que tu
viennes.'").
Une volition est
une intention de réaliser un désir (à soi).
Une volition est
un acte volontaire.
Par exemple, on
peut avoir l'intention de partir, on peut avoir l'intention de faire partir un
autre sujet, on peut vouloir ou désirer qu'il parte, mais on ne peut pas avoir
l'intention qu'il parte.
Il est impossible de vouloir ce dont on est certain
de l'impossibilité.
Par exemple, si
on désire être immortel et qu'on est certain de l'impossibilité de l'être,
il est impossible de vouloir l'être.
La velléité
est l'inintentionnalisation de désirs dont on n'est pas certain de l'irréalisabilité,
ou le fait que l'intention représentative ne cause pas l'intention présentative.
Par exemple, si
une personne désire arrêter définitivement de fumer mais ne passe jamais à
l'acte, ou s'il décide d'arrêter mais prend une cigarette cinq minutes après,
c'est de la velléité.
Par exemple, la
paresse, la timidité et la lâcheté sont des types de velléité.
Si un sujet a un désir dont il est certain qu'il est
irréalisable, il ne peut y avoir ni volonté ni velléité pour ce désir.
Par exemple, si
une personne désire être immortelle mais est certaine que c'est impossible de
l'être, elle ne peut avoir ni volonté ni velléité pour ce désir.
*
Tableau
analogique 4, sur la perception et l'acte:
Schéma 3, sur
la perception et l'acte:
* Utiliser quelque chose, c'est intentionnellement avec cette chose faire autre chose.
*
Un geste est
un mouvement intentionnel des membres ou de la tête.
*
Montrer,
c'est faire voir intentionnellement quelque chose à un autre sujet en lui
faisant intentionnellement comprendre l'intention de lui faire voir cette chose.
La monstration implique la communication.
La monstration implique la déicticité.
Cacher,
c'est intentionnellement ne pas faire voir.
*
Regarder,
c'est voir intentionnellement et attentivement.
Écouter,
c'est entendre intentionnellement et attentivement.
Palper,
c'est toucher intentionnellement et attentivement.
*
Un agent est
une chose qui cause une conscientisation, un réflexe ou un acte.
Par exemple,
les instincts sont des agents; les objets de perception(s) (ce qui est perçu)
en sont aussi des agents, mais ce ne sont pas les seuls.
*
Un effort
est un comportement (qui
en fatigue le sujet.
L'effort
est le fait pour un comportement d'en fatiguer le sujet.
Par exemple,
une maladie peut fatiguer mais n'est pas un comportement (c'est la fièvre, la
production d'anticorps, etc. qui fatigue).
Le repos
est le fait de ne pas faire d'effort ou de cesser un effort. Effort —> Fatigue —> Repos —> Effort
*
La difficulté
est le fait (pour une chose) de nécessiter beaucoup d'efforts (pour être réalisée).
La facilité est
le fait (pour une chose) de nécessiter peu d'efforts (pour être réalisée).
Un
talent est une capacité à faire quelque chose plus facilement que
la plupart des autres sujets (de la même espèce, de la même collectivité). Un talent est une facilité à faire quelque chose supérieure à celle d'autres sujets (de la même espèce, de la même collectivité).
*
Aider,
c'est permettre de réaliser plus facilement une intention.
*
La complexité
est la difficulté à comprendre, à être compris.
La simplicité
est la facilité à comprendre à être compris.
*
La liberté
est la capacité de réaliser intentionnellement ses désirs.
Si un désir est réalisé inintentionnellement, par
exemple par hasard ou nécessairement, il n'est pas réalisé librement.
Si un sujet réalise ses désirs par hasard (ou si
les désirs d'un sujet sont réalisés par hasard), il n'est pas libre.
Si un sujet désire que ses désirs soient réalisés
par hasard, il n'est pas libre de la réalisation de ce désir.
*
Une décision est
un acte (psychique) d'avoir une intention (représentative et non présentative).
Décider,
c'est intentionnellement réaliser l'intention d'avoir une intention (représentative
et non présentative).
Par exemple, décider
de voter, c'est faire l'acte d'avoir l'intention de voter, mais ce n'est pas
voter et ça n'implique pas de voter.
On peut décider un autre sujet, c'est-à-dire
intentionnellement lui faire avoir une intention.
Hésiter,
c'est ne pas encore réussir (ou échouer) à se décider.
Un renoncement
est une décision de ne pas faire, être ou avoir ce qu'on désirait ou
qu'on aime faire, être ou avoir.
Par exemple,
renoncer à être président, c'est décider de ne pas l'être; renoncer à
avoir une voiture, c'est décider de ne pas en avoir.
Se résigner,
c'est ne plus essayer de ou renoncer à modifier quelque chose (qu'on désirait
ou qu'on avait l'intention de modifier) car on croit que c'est impossible, trop
difficile ou trop risqué de le faire.
Choisir,
c'est décider (d'avoir, être ou faire) quelque chose plutôt qu'autre chose.
Le libre-arbitre
est la capacité, le pouvoir de choisir.
*
Feindre,
c'est intentionnellement faire comme si on faisait quelque chose, sans avoir
l'intention de le faire réellement, et sans le faire réellement.
La feinte est un acte de représentation.
Par exemple, si
j'ai l'intention de feindre de gifler une personne, et que je frappe réellement
sa joue en étant trop proche (donc par erreur, par mégarde,
inintentionnellement), j'échoue à feindre cette gifle, et donc je ne feins pas
puisque je la gifle réellement.
Par exemple, si
on feint de gifler ou de donner un coup de poing, on fait le même geste, mais
sans frapper; des enfants feignent de conduire une voiture à l'arrêt en
s'asseyant réellement sur le siège du conducteur, en tournant le volant, en
actionnant le levier de vitesse, etc.; un romancier feint de faire des énonciations
en écrivant réellement des phrases; par contre, un mot ne peut pas être une
feinte.
Une fiction est
un système de feintes ou de choses feintes.
Par exemple,
dans une salle de spectacle, un mime, muni d'un filet pourchasse un papillon; il
retient son souffle, avance sur la pointe des pieds, s'arrête, abat vivement
son filet; manqué! il suit le papillon des yeux, s'en approche à nouveau, le
capture cette fois; entre le pouce et l'index il prend délicatement l'insecte
qui se débat; il n'y a pas de filet, il n'y a pas de papillon, le regard du
mime est perdu et ses doigts refermés sur le vide; or il n'y a réellement
aucun papillon la salle; les spectateurs savent que la représentation mentale
qu'ils ont construite ne correspond pas à la réalité.
Par exemple,
les romans, la plupart des histoires drôles, la plupart des bandes dessinées
sont des fictions.
Par exemple, un
romancier, n'écrit pas des affirmations, il ne ment pas: il n'essaie pas de
faire croire à d'autres personnes ce qu'il ne croit pas; quand il écrit
"`Où étiez-vous à l'heure du crime?'", il ne questionne pas, mais
il fait une représentation de question, faite par une personne qui n'existe
qu'en représentation à une autre qui n'existe aussi qu'en représentation.
Par exemple, un
personnage peut être fictif (c'est-à-dire faire partie d'un système de
feintes) mais pas fictionnel (c'est-à-dire être, constituer un système de
feintes).
Fictif
Systématique
Fictionnel
Systémique
Une fiction peut représenter quelque chose de réel.
Par exemple, la
reconstitution d'un assassinat afin d'élucider une enquête policière ou
judiciaire est fictionnelle: on ne refait pas réellement l'assassinat
reconstitué.
Souvent, lorsqu'on fait ou perçoit une fiction, on
l'oublie, c'est-à-dire qu'on devient peu conscient qu'il s'agit de représentations,
et non de réalités, et on agit comme s'il s'agissait de quelque chose de réel,
car on est surtout attentif à ce qui représenté, à ce qu'on perçoit.
Par exemple, on
parle d'un personnage de roman comme d'une personne réelle: "Sherlock
Holmes vit à Baker Street.", "L'assassin a dissimulé la vérité à
Sherlock Holmes.", etc..
Une simulation
est quelque chose qui permet de feindre.
Une erreur
est une croyance qui ne représente pas quelque chose de réel, ou un acte ou un
échec causé par une telle croyance ou une ignorance.
Par exemple, ce
peut être une erreur de croire une personne qui ment, ou de ne pas prendre son
parapluie parce qu'on croit qu'il ne va pas pleuvoir.
Tester,
c'est essayer d'avoir une connaissance en modifiant quelque chose (en
interagissant avec, en faisant réagir cette chose).
Par exemple, on
peut tester les connaissance d'une personne en la questionnant, on peut tester
la résistance d'une planche en mettant des poids dessus ou en la tordant.
La perfection est le fait d'être totalement réalisé selon les désirs, les intentions ou la fonction. L'imperfection est le fait d'être partiellement réalisé selon les désirs, les intentions ou la fonction. * L'autonomie est le fait de faire quelque chose sans un autre sujet. L'autonomie, est la capacité à choisir et respecter ses propres normes. L'hétéronomie est le fait de nécessiter d'autres sujets pour faire quelque chose.
L'autonomie
est le fait de réaliser soi-même ce qu'on désire.
L'hétéronomie
est le fait de ne pas réaliser soi-même ce qu'on désire. Par exemple, on est autonome pour l'approvisionnement en eau si l'on obtient soi-même son eau par son puits ou par la collecte des eaux de pluies, et hétéronome si il faut l'acheter à autrui; autonome si on obtient son électricité avec son moulin à eau, son éolienne ou ses panneaux solaires, et hétéronome si il faut l'acheter à une firme; autonome si on peut faire le bricolage chez soi, et hétéronome s'il faut payer les services d'artisans. La domination du marché cause une augmentation de l'hétéronomie, qui favorise la puissance des marchands. |